Et voilà, nous sommes le 14 février 2009 (vous avez déjà remarqué, un jour par an, sans trop savoir pourquoi, on se retrouve avec son prénom écrit partout, dans les vitrines, sur les affiches...).
Le 14 février 2006 — c’était il y a trois ans et un mardi — j’achetai mon premier ordinateur. J’avais convié mon frère (qui ne dit jamais non à une séance de shopping geek), et j’étais résolument en quête du plus bas prix possible ; nous nous sommes donc laissés avoir convaincre par le gars de la boutique, qui m’a refilé un portable Acer tout pourri (on m’excusera le pléonasme), lequel a connu pas moins de huit retours en atelier lorsqu’il était sous garantie, et dont j’ai moi-même changé toutes les pièces une par une lorsqu’il ne le fut plus (de mémoire : batterie, mémoire, ventilateur, dalle, et pas plus tard qu’aujourd’hui je viens de tout démonter pour mettre de la pâte thermique digne de ce nom).
À cette époque bien sûr, il n’était même pas question pour moi d’avoir Internet. J’habitais alors dans un cabanon au fond d’un jardin dans la belle ville de Saint-Maur des Fossés (Val de Marne, moyenne d’âge 65 ans, mairie de droite dure depuis des siècles). Cela faisait déjà neuf mois que Lewis Trondheim et moi-même travaillions, exclusivement par e-mail, à l’écriture de l’opéra, et il n’avait pas toujours été facile de dissimuler à mon acolyte que je n’avais ni ordinateur ni connexion.
Et pourtant, ce mardi 14 février, je me retrouvais dans une boutique, à payer de ma poche un portable tout pourri et un système d’exploitation que je n’utiliserais jamais. Quelle mouche geek m’avait donc piqué ?
Revenons quelques mois en arrière. Ayant défini le projet dans ses grandes lignes, nous nous étions donc mis au boulot avec en tête quelques contraintes bien précises : j’écrivais pour une petite compagnie totalement dépourvue de moyens financiers. pour des chanteurs que je connaissais, et qui seraient accompagnés, au pire, simplement au piano, au mieux, par un petit ensemble instrumental avec qui j’avais également pris contact.
J’avais d’ailleurs entrepris de partir moi-même, tout seul comme un grand, à la pêche aux subventions. Subventions pour l’écriture, ou pour la production (les costumes, les chanteurs etc) ; c’est peu dire que je n’en trouvai mie. Pour ce qui est de l’écriture, les différentes structures à la con auxquelles je me suis adressé m’ont traité comme il se doit (c’est-à-dire comme un con) ; quant à l’État... Eh bien, disons que dans le milieu des compositeurs il y a une blague qui circule :
— « Quand tu sollicites une commande d’État, tu sais quel est le principal critère pour espérer l’obtenir ?
— Euh, non....
— Oh, bin c’est pas compliqué : il suffit d’avoir déjà eu au moins trois commandes d’État. »
Bref, ça s’annonçait, euh, comment dire... Mal.
La première (et la vraie) mauvaise nouvelle, c’est qu’à peine trois semaines après que nous avions commencé à écrire ce projet, Michel Blin, le metteur en scène de la petite compagnie dont je vous parlais... Michel Blin est mort.
Cancer, foudroyant ; il avait à peine la cinquantaine.
J’avais eu l’occasion de rencontrer sa femme et sa fille Charlotte ; pas une semaine ne s’est écoulée depuis cet été sans que je n’aie une pensée pour elles. Il avait vaguement été question que Charlotte prenne des cours de piano avec moi ; nous n’en avons plus jamais reparlé.
Michel Blin, je lui dois absolument tout ce que je sais sur l’opéra, sur la mise en scène et sur l’humour. Je le dis parce que c’est vrai ; tout comme Michel, j’ai horreur des grands mots. Michel était un type extra, un excellent metteur en scène et, très probablement, un futur auteur (je sentais que cela le titillait depuis longtemps, et j’attendais avec impatience de voir quelles idées il allait nous sortir).
Je n’ai pas mis les pieds à son enterrement. C’était l’été, et j’ai préféré rester à la maison avec ma femme. D’abord parce que je suis contre les enterrements, je trouve ça con (je ne sais pas ce que Michel en pensait, mais c’est le genre de phrase qu’il aurait pu dire). Ensuite par respect pour sa famille (vous sauriez quoi faire, quoi dire, vous ? Moi non.) ; et enfin par respect pour le souvenir que j’avais de lui ; certains de la compagnie y sont allés pour chanter de la musique, cette idée seule me ferait fuir en courant. Au moins, aujourd’hui je peux penser aux opéras qu’on a faits, à l’humour et à la vie qu’il y avait là-bas, sans que cette horrible image d’église et de mort vienne s’imposer à moi.
On en était là. Et puis, un matin, c’était le dimanche 29 janvier 2006, un gros coup de sang.
Le coup de sang, c’est celui qui s’est emparé de moi, et qui s’emparerait de quiconque est réveillé en sursaut par le téléphone un dimanche à 8h30 du matin. Au bout du fil, un des chanteurs pour qui j’écrivais l’opéra (Mario Hacquard, à qui était destiné le rôle du Roi) ; à l’autre bout du fil, un Valentin mal réveillé, tout juste sorti de sa couette et grelottant dans son cabanon, le téléphone posé sur le piano.
— Gnéé ?
— AllôValentin, ouisalut c’est Mario. (Mario parle vite.) Bondisdonc, t’asvu, il a eu le Prix !
— Gnngnmff ?
— Lewis Trondheim, il a eu le Prix du festival d’Angoulême !
— ... Gnnneéalors ?
— Bintuterendscompte, c’est génial, çatefait une pub inouïe ! Je pense qu’il y a moyen de frapper un gros coup...« Le gros coup, c’était de cesser de laisser en plan mes amis chanteurs, d’oublier la compagnie, les musiciens, les veaux les vaches et les cochons, et d’envoyer l’air de rien ma partition à un grand Opéra de France. Comme à son habitude (mais qui ne l’a pas, dans ce milieu), Mario se met à me débiter tout un tas de noms propres : »Ah oui, à Tours le directeur c’est Machin, ça pourrait l’intéresser ; à Strasbourg il y a Bidule, tu connais Bidule, il serait facile à contacter aussi, tu l’appelles de ma part"....
J’ai mis quelques jours à reconstituer toute la liste ; le nom que j’avais le plus retenu était celui de René Koering, pour la simple raison qu’il était à Montpellier et que Lewis habite aussi à Montpellier, ça faisait plus simple à retenir. (Quant on ne connaît que deux-trois villes en France, on est vite perdu.)
Bon. Vite fait bien fait, je bricole (sur le Mac de ma femme, sous OpenOffice) un dossier pour présenter l’opéra ; j’y joins la partition du prologue de l’opéra, copiée à la hâte sous Sibelius.
Nous étions le dimanche 5 février, vers 16 heures ; en branchant le Mac sur la prise téléphonique, on se fait une connexion bas débit, le temps de choper l’adresse de l’opéra et de poster le mail (je vous raconte pas le suspense, pendant les dizaines de minutes qui se sont écoulées le temps que les deux pièces jointes se transfèrent...)
Ma femme et moi avions un train à prendre, pour aller chez mes grands-parents (où je me trouve à nouveau aujourd’hui, et où j’ai écrit les deux tiers de l’opéra). Le transfert s’étant achevé juste à temps, on se met en route, on cavale, on chope le RER, puis le train, puis on arrive à destination. À peine arrivé, je vais squatter l’ordinateur de mon grand-père (que je squatte encore aujourd’hui), vérifie mes mails et...
Surprise ! Un message m’attendait, et il était de René Koering, qui trouvait mon projet « tout à fait excitant » et qui se déclarait prêt à créer notre ouvrage à l’Opéra de Montpellier.
Quelques jours plus tard, je rentrais à Paris et m’achetais un ordinateur.
On allait passer aux choses sérieuses.
Épilogue.
Aujourd’hui, je n’ai plus de contact avec les chanteurs pour qui j’ai écrit cet opéra. Rien d’anormal : ça va ça vient, dans ce métier.
Il y a quelques mois, avant que le casting ne commence pour cet opéra, René Koering m’a demandé si j’avais des chanteurs à lui proposer. J’ai donné les noms de certains de mes collègues ; il s’est avéré que ce sont eux qui ont refusé de venir participer au projet. Pour plein de raisons : ils ont déjà du boulot à Paris ; le projet ne les intéressait pas, ou bien ils trouvaient soudain ma musique « chiante à chanter » — Mario Haquard dans le texte : « ya des tritons partout, c’est chiant ».
La petite compagnie dont je vous parlais continue à tourner, et sans doute à faire du bon boulot. Je n’ai plus eu de nouvelles non plus ; d’abord parce que j’ai cessé d’être pianiste pour écrire cet opéra, et ensuite parce que.... eh bien, ça va ça vient, comme je vous disais.
J’ai pris soin de leur signaler, dès le début du projet, que la partition serait sous licence libre et qu’ils auraient ma bénédiction pour le représenter par leurs propres moyens. Mais au fond, je ne pense pas que cela les intéresse.
J’ai vaguement dédié cet opéra à Michel ; je n’ai jamais revu sa femme et sa fille (vous sauriez quoi faire ? moi non).
Et on est déjà le 15 février. D’ici quelques heures, les commerçants vont pouvoir remballer leurs gros cœurs rouges et leurs slogans débiles. Les employés du ministère de la Culture continueront à collecter les dossiers de sollicitation de commandes d’État, et à les ranger en piles. Les rombières des fondations caritatives iront se délecter de l’histoire teellement touchante de ce jeune compositeur colombien néo-sériel sidéen à qui on a daigné donner la bourse de cette année, moyennant une jolie photo les yeux emplis de gratitude pour faire bien dans le journal. Des curés iront célébrer les obsèques de metteurs en scène anarchistes, au son de trios de Mozart.
Dans des banlieues bourgeoises, de jeunes dandys désargentés monteront, un peu plus, et avec un regard méfiant vers le compteur électrique, le thermostat de l’unique radiateur de leur cabanon vétuste.
À Angoulême, les balayeurs doivent être en train de ranger des posters, de finir de nettoyer les hangars du festival de cette année, pendant qu’un peu partout ailleurs des chanteurs, des auteurs de BD et des profs de piano à la petite semaine cherchent mollement la promesse d’un avenir meilleur.
Et moi, je vais me coucher.
Valentin
 [Le Site]
[Le Site]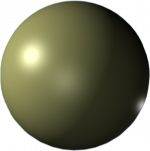 14 - Ma vie est passionnante (III) : changement de plan.
14 - Ma vie est passionnante (III) : changement de plan.
Messages
15 février 2009, 10:43, par mamaloubr
Et puis ils parlent de leurs petites affaires, de leurs enfants, de leurs bronches ; le jour se lève, on tire les rideaux chez le Président.
Dehors, c’est le printemps, les animaux, les fleurs, dans les bois de Clamart on entend les clameurs des enfants qui se marrent, c’est le printemps, l’aiguille s’affole dans sa boussole, le binocard entre au bocard et la grande dolichocéphale sur son sofa s’affale et fait la folle.
Il fait chaud. Amoureuses, les allumettes-tisons se vautrent sur leur trottoir, c’est le printemps, l’acné des collégiens, et voilà la fille du sultan et le dompteur de mandragores, voilà les pélicans, les fleurs sur les balcons, voilà les arrosoirs, c’est la belle saison.
Le soleil brille pour tout le monde, il ne brille pas dans les prisons, il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la mine,
ceux qui écaillent le poisson
ceux qui mangent de la mauvaise viande
ceux qui fabriquent des épingles à cheveux
ceux qui soufflent vides les bouteilles que d’autres boiront pleines
ceux qui coupent le pain avec leur couteau
ceux qui passent leurs vacances dans les usines
ceux qui ne savent pas ce qu’il faut dire
ceux qui traient les vaches et ne boivent pas le lait
ceux qu’on n’endort pas chez le dentiste
ceux qui crachent leurs poumons dans le métro
ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d’autres écriront en plein air que tout va pour le mieux
ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire
ceux qui ont du travail
ceux qui n’en ont pas
ceux qui en cherchent
ceux qui n’en cherchent pas
ceux qui donnent à boire aux chevaux
ceux qui regardent leur chien mourir
ceux qui ont le pain quotidien relativement hebdomadaire
ceux qui l’hiver se chauffent dans les églises
ceux que le suisse envoie se chauffer dehors
ceux qui croupissent
ceux qui voudraient manger pour vivre
ceux qui voyagent sous les roues
ceux qui regardent la Seine couler
ceux qu’on engage, qu’on remercie, qu’on augmente, qu’on diminue, qu’on manipule, qu’on fouille qu’on assomme
ceux dont on prend les empreintes
ceux qu’on fait sortir des rangs au hasard et qu’on fusille
ceux qu’on fait défiler devant l’Arc
ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier
ceux qui n’ont jamais vu la mer
ceux qui sentent le lin parce qu’ils travaillent le lin
ceux qui n’ont pas l’eau courante
ceux qui sont voués au bleu horizon
ceux qui jettent le sel sur la neige moyennant un salaire absolument dérisoire
ceux qui vieillissent plus vite que les autres
ceux qui ne se sont pas baissés pour ramasser l’épingle
ceux qui crèvent d’ennui le dimanche après-midi parce qu’ils voient venir le lundi
et le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi et le samedi
et le dimanche après-midi.
Jacques Prévert« Tentative de description d’un dîner de têtes en Ile de France » [extrait]